Première année : A la recherche du Temps perdu…

La médecine fait le cinéma… Thomas Lilti, médécin, réalise le film Première année, à la suite d’autres films Médecin de campagne, sorti en 2016 et Hippocrate deux ans plus tôt. La répétition d’un sujet filmé à l’écran, exploité de manière différente selon les films, fait de son œuvre cinématographique un marqueur du temps passé, un temps de l’exploration où le renouvellement formel constitue la trame d’une existence, d’une exigeante histoire : celle qui raconte comment devenir et être médecin, à ses propres yeux d’abord, aux yeux des autres ensuite, ou inversement…

© Le Pacte
Médecine e(s)t fiction
Au cœur, la médecine. Ici les études, ou du moins, ce qu’il en reste. Les premières images confirment le coup porté au « mode de vie » des étudiants en médecine. Les clichés sont évités, même pas effleurés. Débutant par une scène où l’un des héros principaux, dans sa chambre étudiante, flânant sur son ordinateur, oisif et heureux, s’approprie doucement le lieu. Le mensonge s’ouvre sur une scène familière du faire semblant de « travailler » à défaut de savoir comment le faire… La prise de marque, les retards répétitifs, tout semble concourir contre le héros, contre son intégration dans le milieu. Ailleurs, il ne saisit pas encore les subtilités de son environnement, seul, porté par le courant, et nageant contre-courant, semble-t-il, sa démarche et sa silhouette se détachant du décor de l’université, frappant notre regard par cette impossibilité, au début du moins, à se fondre dans le paysage. Opérant en trompe l’œil, il devient l’esquisse d’un personnage presque kafkaïen, absent, dans un environnement impossible à maîtriser, en apparence imprévisible pour le novice qu’il incarne. Le spectateur, aussi, assiste novice, impuissant à la déroute qui prend forme. Peut-il devenir médecin, ainsi ?
Vraisemblablement, si la réponse semble être simple, si le doute que l’on éprouve à sa vue s’impose à nous de façon évidente, à nous, extérieur à tout, comme son père qui joue le rôle « d’opposant » dans la trame narrative, dans l’histoire personnelle du héros, l’élément perturbateur survient. Il provient de la nécessaire rencontre avec un « ami », un adjuvant, si l’on ose dire, à sa quête. Lui-même, en quête aussi, organise la rencontre avec notre héros de manière toute calculée : la balance entre l’offre et le don s’établit d’emblée comme ciment et moteur de la relation qui les lie, où la sympathie et la complicité semblent noyées devant les impératifs horaires, l’entraînement à la réussite – ou l’échec, de la vie de jeune étudiant en médecine.
La fiction prend donc l’allure d’une sorte de huis-clos au milieu d’un décor, de la foule, dans l’université parisienne, les bancs de la fac, les centaines d’étudiants… Ce décor est minimaliste et est comme aspiré tout entier par les personnages, duo qui façonne sans cesse l’espace, à son image, selon leurs désirs respectifs. Celui d’être médecin pour l’un, celui d’être un ami et un fils, pour l’autre.
Le travail, c’est la santé… La médecine n’en est pas une.
Derrière le décor qui constitue la scène théâtrale, on sent les corps façonnés par l’effort intellectuel, renforcé par deux choses. Le temps et le découpage scénique. Le rythme calculé et cadré des scènes que nous regardons, le découpage temporel qui s’organise selon deux piliers : les examens de passage. Autour, seule la façon de réviser compte. Et l’outrance devient assimilable pour eux deux. Décomposer, le temps, disséquer les matières, les sujets un à un de façon méticuleuse permet l’absorption d’une dose létale de poison journalier. Et pour tenir, de maigres pauses « maths », des scènes d’efforts physiques (courses dans les rues et les escaliers de Paris) pour habituer le corps qui se doit de suivre, voir de survivre à l’effort intellectuel constant. Tout est bon pour que cette énergie soit évacuée… Soit elle l’est, par l’effort sain et la force de l’habitude pour l’un, soit elle ne peut, elle dégringole, elle épuise son potentiel et ne s’ouvre que sur le vide et l’incapacité de pouvoir prendre du repos. Le surmenage, la surdose, jusqu’à ce que s’effondre, le corps d’abord, et ensuite le monde, de manière soudaine. Et aucune fondation (soutien familial, soutien de l’environnement) ne résiste à l’emportement nécessaire, au ras-le bol général, à la tension accumulée durant tout ce temps que l’on ne voit passer devant l’écran, qui serpente de façon sinueuse et invisible jusqu’à ce que la mécanique de la machine/corps s’enraye.
Jouer le jeu, « maîtrisons les codes »

© Blog : image La tête en Claire
Pourtant, le jeu d’acteur du duo William Lebghil / Vincent Lacoste confirme une dramaturgie sociale où « la maîtrise des codes » sociaux est la seule règle pour réussir… Mais là encore, rien n’est joué d’avance et chacun des deux jeunes étudiants s’extrait des codes en renforçant leur amitié, celle qui les pousse en avant car l’un sans l’autre, la dynamique ne prend pas.
Le jeu s’apparente aussi à une forme de spectacle. Et la concentration, le réflexe reptilien qui automatise chaque geste, chaque pensée, où le dépassement des limites se joue aux examens me renvoient, et je m’égare, à un autre film sur le sport : l’Empire de la perfection (Julien Farault) où l’Idéal se voit maîtrisé par le tennisman John McEnroe qui obtient victoires sur victoires par une maîtrise parfaite de son style, de son jeu d’acteur. L’effort, ici, est aussi intellectuel et passe par le corps mais surtout, ce que l’on retient, c’est que seul la maîtrise du temps et de soi renvoient l’homme à un idéal où il serait, toujours, victorieux sur ses limites. Le temps et l’échec n’auraient aucune prise.
Une dernière image du film, celle où le duo mime le fonctionnement du cœur, ses veines, la circulation sanguine. Un faisant l’aorte, l’autre le sang, etc. Scène où le corps est sans cesse disséqué, révisé, joué, mimé. On en fait des dessins au brouillon, des croquis sur des cahiers… Sujet du film et de la médecine, le corps représente un savoir à obtenir, et donc, la seule richesse valable au-delà de tout déterminisme social.
Mais le film, ludique, dans son montage, rafraîchissant par le jeu relationnel entre le duo, fait oublier que ce que l’on regarde n’est et ne reste qu’une forme de « tranche de vie » que l’on découpe et recoupe pour en faire une fiction qui vaille la peine d’être imaginée, vue.











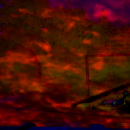

Basquiat à la Fondation Vuitton: la visite enchantée
La complainte du marin moderne : la poésie comme dessein