Ezio Bosso : l’oiseau de la nuit amère

Je pianote sur mon pc depuis une demi-heure, je suis agitée, angoissée par les brèves du soir. Je ne dormirai pas cette nuit. Je la passerai à rêver, éveillée. Pour m’accompagner, je choisis le pianiste italien Ezio Bosso.
Né à Turin en 1971, ses parents ouvriers s’étonnent de son goût inné pour la musique. Jeune prodige, il suit une formation classique à Vienne en Autriche et se produit au Carnegie Hall de New York et à la Scala de Milan. Un cancer du cerveau l’oblige à tout réapprendre à 38 ans. Le langage et la musique lui sont devenus étrangers ; alors il joue, instinctivement, des mélodies plus épurées. Il trouve l’inspiration dans cette épreuve et décide de se vouer corps et âme à la musique « classique » qu’il préfère qualifier de « libre ». Se libérer par la musique de ce corps sclérosé est sa nouvelle raison de vivre. C’est au festival de San Remo, en février 2016, qu’il rencontre son public. Esthète, l’artiste italien communie avec la nature, se met au service de sa beauté et nous la rend accessible.
Voici mes trois morceaux fétiches, trois petites histoires, trois beaux rêves.
Je débute mon songe musical par le poétique Following a bird (The 12th Room, 2016). Le tempo est lent, les premières notes de piano sont comme murmurées, légères et aiguës. Je m’imagine les rayons du soleil perçant les nuages de l’automne, et l’oiseau planant, très haut. Au fur et à mesure qu’il descend grondent les notes plus graves. Succédant au climax, la pause est essentielle dans le jeu de l’interprète. Elle est synonyme d’attente. Le silence d’Ezio Bosso est autre chose que le vide d’un silence embarrassé, il est délectation. L’interprète joue avec les temps. Passé, présent, futur sont cristallisés dans l’instant. Se livrant avec une authenticité touchante, il donne tout, maintenant. Dans un tourbillon frénétique, les répétitions sont comme les variations d’un même thème. Plus je les écoute, plus je saisis la profondeur et la subtilité de son écriture musicale. Les notes montent en intensité, et la mélodie s’envole. L’oiseau finit par se poser, en toute légèreté et avec élégance, sur un tempo tranquille. Le decrescendo final rend presque inaudible le dernier accord, comme si l’oiseau s’était envolé de nouveau, sans bruit.
Speed limit, a night ride (And the things that remain, 2017) est une pièce que j’aime tout particulièrement. Elle est plus joyeuse, plus allègre que les autres. Celle-ci a quelque chose d’enfantin, avec sa tonalité malicieuse. A chaque écoute, je la redécouvre comme si je relisais mon livre fétiche. Ezio Bosso a bien compris l’aphorisme de Goethe « Tous les débuts sont délicieux ; le seuil est l’endroit où l’on fait une pause ». Son amorce est maîtrisée, les pizzicati du violon sont subtils. Les notes se détachent délicatement les unes des autres. J’imagine la scène : au crépuscule, une légère fraîcheur émane des ombres du soir. Une pluie fine se met à tomber, frappant les vitres embuées de ma chambre. Le rythme s’accélère, les éléments semblent danser dehors. Amusée, je regarde d’un œil distrait le chat déguerpissant. Une accalmie, un decrescendo. Puis, brusquement tout s’emballe ! La pluie, la mélodie me font sursauter. Le pianiste frappe avec intensité les touches du piano forte. La tension retombe une ultime fois, jusqu’à se perdre dans les abîmes du silence. La musique me ramène à mon essence, à une pureté utopique. Une formidable communion a lieu entre la nature et mon esprit engourdi.
Sweet and bitter (The 12th Room, 2016), le dernier rêve. Le piano se met à chanter trois notes et à les rejouer inlassablement, mais sans entêtement, jusqu’à me plonger dans le rythme cyclique et chaleureux de la mélodie. Le décor est installé. Puis le violon entre en scène, se fond avec harmonie dans ce décor familier. Frappées ou frottées, les cordes s’accordent merveilleusement. La progressivité du crescendo instaure une tension dramatique. Le dialogue est conciliabule, puis s’intensifie après quelques mesures. La mélancolie du violon répond au jeu impavide du piano. Mais les deux âmes chantantes s’échauffent, se querellent. Le doux se montre bourru et l’amer devient colère ! Les deux instruments ne parviennent plus à reprendre leur souffle, s’époumonent sans s’écouter mutuellement. Insoupçonnable, l’amer veut l’apaisement et fait entendre ses plus feutrés aigus au doux piano. La dispute se mue alors en réconciliation douce-amère. Le duo fusionne dans un symphonique oxymore. Je ressens l’énergie vitale de cette douceur. La note finale laisse place au silence ; c’est l’ultime expiration. Mais le morceau n’est pas achevé, il résonne à l’infini, il résonne encore en moi.
Je me suis endormie.











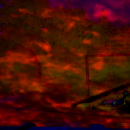


Basquiat à la Fondation Vuitton: la visite enchantée
La complainte du marin moderne : la poésie comme dessein