Kings : éparpillement familial, désolidarisation sociale

Deniz Gamze Ergüven, réalisatrice de Mustang, déplace le cadre de vies adolescentes turques vers les cœurs d’adolescents américains des ghettos de Los Angeles dans son film Kings. Feux ardents.
 Filmer l’événement
Filmer l’événement
États-Unis. Années 90. Ghettos. Un cadre simple. Une famille : une mère, de nombreux enfants recueillis pour la plupart. Joie intérieure et rituels du matin, les pieds baisés, bouts de pieds statufiés des petits corps endormis prompts à s’éveiller, s’amuser, jouer des tours, voler dans le supermarché. Scène d’ouverture, petite fille morte pour un jus d’orange. Et son regard, frontal au premier plan, comme un défi lancé. Le billet chaud encore dans la main froide. L’argent l’envoie en enfer. Pas de petit-déjeuner pour elle, ce matin-là. Pas de prison pour la tueuse, une pauvre femme qui a « agité » son arme à feu innocemment… Balle partie vers destination finale. Le cœur. Au cœur des tumultes, brasse la violence réprimée douloureusement, honteuse de ne pouvoir trouver cible à une colère dévastatrice. La mort d’une enfant. Cris ou silence ? Violence ou deuil ? Peur surtout. Pour les enfants, pour tout le monde.
Et plus tard, survint alors l’image d’archives, les vraies images d’un événement sordide qui aurait pu être gardé secret s’il n’avait été filmé. La mise à tabac, en bonne et due forme, de Rodney King. Puis son procès, que tous suivent à la télé. Sur toutes les chaînes. En parallèle de la cour de cassation, dehors, la vie, violente et rythmée. L’adolescent de la famille s’éprend d’une petite rebelle. Lui, grand frère protecteur cherche à la ramener, à l’éloigner des vagues de violence qui sommeillent partout, et se révèlent à chaque coin de rue. Tension, le quotidien est sur le fil. On a peur d’être saisi, battu. On attend la fin du procès de Rodney. Martyr, représentation, fraternité, figure. D’ailleurs, visage brisé, gueule cassée. Et paraît-il que son joli minois aurait volontairement heurté les battes et les matraques policières. Pluie de coups. Ils aiment s’attarder sur le vivant comme de la viande ? Et les enfants voient les images. Et pourtant, ils jouent encore dans le jardin. Quelques scènes d’un bonheur familial disséminé. Petite baignade dans la piscine. Balançoire. Éclats de rires. Configuration des repas.
Et le voisin, là. Cet homme blanc, qui fait je ne sais quoi dans son appartement. Se promène nu pour exhiber un corps tatoué et musclé. Tapote avec distraction sur les touches de la machine à écrire, regardant peut-être la jolie voisine, aux doux cheveux, à la peau noisette, aux fucks charmants, traquée par l’assistante sociale. Elle et ses enfants. Débordée mais heureuse. Mais dehors, le danger vient, et vite.
 Cadrer la violence
Cadrer la violence
Le procès tombe. Les quatre ordures sont relaxées. On a juste suivi un match de baseball à la TV. Une vie humaine en jeux. La corruption nous saigne. Pas besoin d’en voir beaucoup. L’écœurement se défoule rapidement. On casse, il y a des casses partout, de voitures, de tout un tas de trucs, de chiottes, de gens. On tue. On veut saigner, cogner.
La police est prise d’assaut. Expédition punitive. Plus rien n’existe. On enferme n’importe qui, on insulte et humilie.
Le voisin. L’homme blanc, seul et tranquille, amuse par son comportement ni différent, ni associé, ni dissocié du reste. Il est là. Fume comme tout le monde, hurle quand il y a du bruit, jette ses meubles par la fenêtre. Recueil les gosses pour un goûter pizzas et petite partie de danse dans le dos de la jolie maman. Elle fantasme, et rêve. Scène érotique. Moment à elle, hors des enfants.
Et l’adolescence tumultueuse. Désir bousculé, danger, crise, affrontements, mort. Scène sublime d’un raid en voiture, avancée dans le vide. Brouillard équivoque, fumée, vie qui vole en éclat. Perdition, tristesse, euphorie, joie, peur et feu.
Ou vide alors, scène devant le supermarché. Attaché au lampadaire, le voisin et la mère. Théâtre, jeux de mains, jeux de vilains, flirts manqués, pantalons arrachés. Scène rocambolesque, acrobatie. Jeunesse. Rires.
Heureusement, scènes douces un peu. Une main caressant les larmes. L’humiliation embellie et elle-même sublimée. On attachait les gens aux piloris. Moins d’ingéniosité et la souffrance aurait été insupportable.
Film rythmé où la souffrance n’a pas le temps de s’installer. Elle est disséminée, narquoise, sans paix. Seule l’exaltation, la joie trop vite consommée par crainte de ne plus la ressentir. Comme ce moment, où au volant, elle sourit et chante, salue un passant. Des mots fredonnés chassent les soucis sur son visage. Les enfants, leur avenir, la violence.
Quand elle éclate, c’est l’éclat. Donner le biberon avec des mains menottés, chercher les ados, chercher les gamins qui s’échappent, laisser les plus petits sans surveillance. Se faire embarquer en voulant s’interposer.
La fraternité, dans ce chaos réside à faire un truc, n’importe quoi au fur et à mesure. Pris la peur au ventre, Kings avance sans reculer, la mort en face, le regard fier de tous. De ceux qui parmi la violence vivent sans bruits, sans oublier de rire un peu, sans ironie.
Tout est montré, faut voir. Fauves noirs.











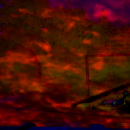


Basquiat à la Fondation Vuitton: la visite enchantée
La complainte du marin moderne : la poésie comme dessein