Vincent Van Gogh, génie ou fada ?

L’insaisissable peintre qui nous fascine et nous émeut, tout simplement dément !
Prénom : Vincent. Nom : Van Gogh. Profession : génie incompris. Tout le monde connaît le Hollandais fou, Vincent pour les intimes. Né en 1853 à Groot Zundert aux Pays-Bas (on repassera pour la prononciation, bilingues s’abstenir de frimer) et mort vraisemblablement par suicide 37 ans plus tard, à Auvers-sur-Oise. La vigne rouge à Montmajour (Arles, novembre 1888), ça ne vous dit rien ? C’est pourtant le seul tableau qu’il ait vendu de son vivant à Anna Bosh, l’épouse de son grand ami le peintre Eugène Bosh. Je l’imagine bien le Gégène, quelques mois à peine avant que son bro passe l’arme à gauche, glisser à sa douce « Dis 400 balles pour Vincent, c’est pas de trop, et puis c’est un bon petit gars qui mérite pas la lose ». Entre 1872 et 1890, Vincent a écrit 680 lettres à son frère Théo (souvent pour lui demander de la thune), qui lui répondait une fois sur 8,5 très exactement. J’ai lu toutes ses lettres, avec délice, parce que je voulais m’imaginer un peu l’homme derrière le couteau de peinture -il aimait la matière épaisse. On découvre un homme doué d’une grande sensibilité, qualité intrinsèque à l’artiste, et d’une étonnante modestie, qualité pas du tout intrinsèque à l’artiste. Et le bonhomme était très cultivé. Passionné de théologie, il a gardé ses bonnes vieilles habitudes de prédicateur. Certes, il utilise le présent de vérité générale à tout-va, mais sa pensée est fine et d’une sagesse surprenante. Ses réflexions s’inspirent des génies de la littérature française : il cite les plus grands écrivains du XIXème –the big Four-, Hugo, Balzac, Zola et Flaubert.

Même s’il ne cherchait pas la « fame » des grands génies littéraires et artistiques de son époque, nul doute que Vincent aurait aimé qu’on accorde un peu plus de crédit (financier) à son œuvre. Lorsqu’il arrive à Paris en février 1886, c’est l’âge d’Or des Impressionnistes. Monet, Pissarro, Degas, Cézanne, connus pour leur irrévérence envers le style classique, peignaient le vivant sans le figer sur la toile. Van Gogh est ce que l’on appelle un Postimpressionniste defaçonàcequelalogiquechronologiquesoitrespectée, qui est aussi la bannière de Paul Gauguin, son ami fidèle et coloc’ de la Maison Jaune à Arles, amoureux fou de la couleur et des petites tahitiennes. Vincent a le cul entre deux chaises : il peint dehors tel un Impressionniste, bravant la rudesse du froid hollandais et le soleil brûlant de Provence ; il ne peint pas le vivant, il peint le mouvement du vivant. Le rendu n’est pas aussi « gluant » que Munch (vous me pardonnerez l’expression), mais d’un onirisme coloré, un peu comme si on voyait la vie à travers un kaléidoscope, et on en prend plein les mirettes. C’est en cela qu’il va plus loin que les peintres du Salon. Harmonie de la composition, lignes japonisantes (s’inspirant de sa collection personnelle d’estampes japonaises) couleurs vives, luisantes, irréelles.

Fada : adjectif qualificatif issu du provençal*, étymologiquement « touché par les fées », synonyme de « simple d’esprit », autrement dit : fou. En février 1888, Vincent déboule à Arles, ville charmante de 20 000 âmes qui a les faveurs de la lumière japonaise (un jour, j’irai vérifier par moi-même son analogie). Il est ébloui, littéralement. Ses toiles deviennent visions. La lumière crame tout, déforme les couleurs, brouille les traits. De plus en plus exalté, il peut rester pendant 12 heures devant le chevalet, dans sa petite chambre arlésienne. « Rôdeur nocturne », il descend quatre à quatre les marches qui le séparent du Café la nuit (septembre 1888) pour boire un petit jaune – c’était de temps béni de la fée verte, ancêtre de notre bon vieux pastis- ou pour croquer les pauvres âmes esseulées, sur un fond rouge-verdâtre qui fout la gerbe sans avoir bu. Au terme de trois nuits de travail, il tient l’un de ses futurs chef-d’œuvres, les couleurs tranchent furieusement et gisent « les terribles passions humaines ». Du fond dans la forme. Cool, ça se vendra…ou pas ! Puis, non sevré d’escapades noctambules, il titube jusqu’aux quais du Rhône, à quelques mètres à peine de la Maison Jaune. Dans la douce nuit de ce mois de septembre, il s’inspire des étoiles qui dansent pour peindre Nuit étoilée sur le Rhône.

Comment définir cet artiste aussi intense que mystérieux ? Autodidacte génial, maîtrisant la théorie des couleurs et des contrastes ou fada qui se découpe l’esgourde et qui l’envoie à sa putain préférée ? J’ai envie de finir ma petite causerie par ses mots à lui, à l’artiste. Après tout il a bien mérité sa gloire et sa postérité : « Il doit être bon de mourir avec la conscience d’avoir fait quelque chose de bien dans sa vie, d’être assuré de survivre au moins dans le souvenir de quelques personnes, et de léguer un exemple à ceux qui viendront ensuite ».
*dialecte occitan lexicalisé par Frédéric Mistral en 1886
Crédits photo: Iridha Louloudhi











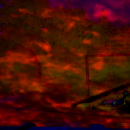


Basquiat à la Fondation Vuitton: la visite enchantée
La complainte du marin moderne : la poésie comme dessein